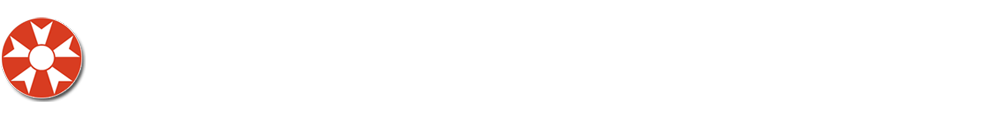C’est pour le seul Eugène que le nom de famille Sue reste aujourd’hui connu du grand public. Sans doute est-ce à juste titre que la postérité a surtout retenu Les Mystères de Paris et Le Juif errant parmi les autres œuvres d’un auteur prolifique, et que celui-ci reste plus réputé comme écrivain que comme médecin. Mais c’est injustement que cette renommée personnelle occulte la contribution de la famille à la santé, au bénéfice de laquelle elle produisit quinze chirurgiens sur cinq générations, de 1699 à 1856, participant à l’intégration progressive de la chirurgie à la médecine.
Une famille de chirurgiens
Le famille Sue est provençale, originaire de Castellet-lès-Sausses (Alpes-de-Haute-Provence), dans le pays d’Annot, et installée à la fin du xvie siècle à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), dans le Vençois. Ses membres étaient alors des officiers civils locaux. À dater de 1699, deux frères, Marc et Pierre, fondèrent deux branches de chirurgiens, à une époque où la chirurgie, considérée comme un artisanat conformément à son étymologie (le grec kheirourgia, littéralement « activité manuelle », composé de kheir, « main », et d’un dérivé d’ergon, « travail »), aspirait à la reconnaissance universitaire de la médecine.
Sept membres de la première branche exercèrent cette activité jusqu’en 1824, dans le Vençois et ailleurs. Le premier, Marc (1663-1670 – 1739) s’installa comme chirurgien-barbier, c’est-à-dire habilité aux interventions superficielles, et contribua activement à fonder en 1722 l’hôpital de La Colle-sur-Loup, dont il resta chirurgien jusqu’à sa mort, ainsi que son fils Alexandre (1714) jusqu’en 1740. Les trois fils de celui-ci furent aussi chirurgiens. L’aîné, Jean (1743 – 1820), chirurgien militaire, se forma pendant la guerre de Sept Ans (1763) et finit sa carrière affecté à l’armée d’Italie (1792 – 1811), avant de se retirer à Grasse, et d’apprendre le décès prématuré en Espagne de son fils Fortuné-Joseph (1793 – 1811), chirurgien sous-aide-major. Le cadet, Jean-François (1754 – 1794), s’installa comme maître chirurgien à Rocheservière (Vendée) et en devint maire en 1790. Le benjamin, Jean-Antoine (1757), fut reçu maître chirurgien au collège royal d’Orléans (1781) et docteur en médecine à Paris (1805). Il enseigna l’anatomie à l’académie de peinture et de sculpture d’Orléans et l’accouchement à l’hôtel-Dieu d’Orléans. Son fils Jean-Joseph (1786 – 1824) devint chirurgien militaire en 1805 et reçu docteur en médecine à Paris en 1814. Il fut nommé membre de la Légion d’honneur en 1813. Il suivit la Grande Armée et la Garde impériale, dont l’hôpital était dirigé par son homonyme Jean-Joseph, cousin issu de germains de son père.
Ce dernier Jean-Joseph était en effet un petit-fils de Pierre (1670 – 1714), frère cadet de Marc. Négociant et bourgeois de Saint-Paul-de-Vence, Pierre fut l’auteur de la seconde branche, tôt devenue parisienne et sensiblement plus brillante que la première.
De ses trois fils, seul l’aîné ne fut pas chirurgien. Le rameau qu’il fonda en compte cependant trois, dont deux légionnaires au xixe siècle, à côté d’au moins six autres légionnaires : un médecin militaire, quatre officiers militaires, dont deux consécutifs, et un architecte décorateur. Un fils, Benoît (1736 – 1808), maître chirurgien, fut chirurgien-major des armées du roi, du château et de l’arsenal de Nantes, et grand-croix de Saint-Michel. Son fils, Benoît-Pierre (1776 – 1836), fut d’abord chirurgien aide-major à Brest (1795), puis reçu docteur en médecine (1812). Il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1821. Son neveu à la mode de Bretagne Georges-Antoine-Thomas (1792 – 1865) fut aussi chirurgien militaire (1813 – 1819), puis docteur en médecine (1816). Installé à Marseille, il devint médecin-chef de l’hôtel-Dieu (1831 – 1855) et directeur de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie (1851 – 1856). Il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1847 et promu officier en 1850. Sa retraite en 1856 mit fin à l’engagement continu de la famille Sue dans la chirurgie.
Auparavant, Pierre avait encouragé ses deux cadets, Jean et Jean-Joseph, à chercher fortune à Paris, où ils fondèrent deux autres rameaux de chirurgiens. Tous deux et l’un de leurs fils furent notamment prévôts du Collège de chirurgie et conseillers du comité perpétuel de l’Académie de chirurgie. Le Collège de chirurgie était la corporation des chirurgiens. Il était administré par un prévôt perpétuel et quatre prévôts élus ; un receveur présidait le jury de réception à la maîtrise. L’Académie de chirurgie était en revanche un établissement royal d’enseignement, créé en 1731 en lieu et place de la confrérie de Saint-Côme-et-Saint-Damien, installée comme elle dans l’actuelle rue de l’École-de-Médecine, elle-même dénommée d’après l’institution qui succéda en 1794 à l’Académie de chirurgie et à la faculté de médecine de Paris et qui fut intégrée à l’université en 1797.
Le fils cadet de Pierre, Jean (1699 – 1762), monta donc à Paris en 1715. Il y fut reçu maître chirurgien juré, c’est-à-dire habilité aux interventions internes (1728), et élu prévôt du Collège de chirurgie de 1744 à 1750, particulièrement engagé dans un procès opposant de 1743 à 1749 les médecins aux chirurgiens, dont la formation venait d’être implicitement reconnue comme universitaire. Il publia aussi un traité de chirurgie, une flore et une pharmacopée. Son fils et biographe Pierre (1739 – 1816) publia bien davantage et s’impose comme l’un des grands hommes de la famille. Reçu maître chirurgien de Paris en 1763, il fut nommé professeur-démonstrateur à l’École pratique de dissection (1767), puis devint adjoint (1773), membre (1775) et secrétaire perpétuel (1792 – 1793) de l’Académie de chirurgie, et parallèlement prévôt (1774) et receveur (1779) du Collège de chirurgie, présidant à ce titre à la réception de plusieurs cousins et neveux comme maîtres chirurgiens. À la Révolution, il fut nommé professeur de thérapeutique (1790), bibliothécaire (1795 – 1809) de l’École de médecine, et professeur de bibliographie médicale (1803) puis de médecine légale et d’histoire de la médecine (1808).
Son oncle Jean-Joseph (1710 – 1792), fils benjamin du Pierre de Saint-Paul-de-Vence, a été identifié à l’hôpital de la Charité de Paris, où il exerça de 1754 à 1779, en dernier lieu en qualité de chirurgien-major, par l’appellation de « Sue de la Charité ». Professeur d’anatomie à l’Académie de peinture et de sculpture (1746), il avait publié d’importants ouvrages (Traité des bandages et des appareils, 1746 ; Abrégé de l’anatomie du corps de l’homme, 1748 ; Anthropotomie, 1750) avant même d’être reçu docteur en médecine (1751). Lui aussi fut membre de l’Académie de chirurgie (1754), ainsi que de plusieurs sociétés de médecine étrangères, et prévôt du Collège de chirurgie (1768 – 1786).
Jean-Joseph Sue (1710 – 1792)
par Guillaume Voiriot.
Source : Wikimedia.
Son fils et homonyme, Jean-Joseph (1760 – 1830), nous intéresse particulièrement pour avoir été créé chevalier légionnaire en 1808 et confirmé à titre héréditaire en 1815. Maître chirurgien en 1781 et docteur en médecine en 1783, lui aussi exerça à l’hôpital de la Charité (1785 – 1796) et enseigna l’anatomie (1789). Après la Révolution, il fut médecin en chef de l’hôpital de la Garde impériale (1800 – 1812), qu’il dirigea jusqu’en Russie, puis de l’hôpital de la maison militaire du roi, et élu à l’Académie de médecine en 1820. Il était officier de la Légion d’honneur et chevalier de Saint-Michel.
Jean-Joseph, 1er chevalier Sue (1760 – 1830).
Détail de son tombeau au cimetière de Bouqueval.
Source : Clicsouris, Wikimedia.
Les armes attribuées en 1808 se blasonnent d’argent à une plante de pervenche au naturel terrassée de sinople entortillée d’un serpent de sable langué de gueules et senestrée en chef d’une étoile d’azur, à la champagne de gueules chargée d’une croix de la Légion d’honneur d’argent (signe des chevaliers légionnaires). Elles symbolisent l’union de la chirurgie, représentée par la pervenche en raison de ses propriétés cicatrisantes, et de la médecine, représentée par le serpent, attribut mythologique du dieu de la médecine, dans une composition calquée sur celle du bâton d’Esculape.
Armoiries de Jean-Joseph Sue (1760 – 1830)
selon les lettres patentes de 1815, qui remplacèrent
la croix de la Légion d’honneur à l’intérieur de l’écu par une étoile
et la toque impériale en timbre par un casque.
Détail du tombeau. Source : Clicsouris, Wikimedia.
Marié trois fois, Jean-Joseph n’eut de successeur dans la chirurgie que l’aîné de ses fils : Eugène Sue.
Un héritage répudié
Encore Jean-Joseph ne tira-t-il guère de satisfactions de la carrière de son fils. Né en 1804 dans le grand monde, tenu sur les fonts baptismaux par la future impératrice Joséphine et par Eugène de Beauharnais (dont il prit plus tard le prénom en lieu et place des siens), cet aîné fut au lycée Condorcet un élève dissipé. Pris par son père à l’hôpital de la maison du roi en 1823 comme chirurgien sous-aide-major, il fut envoyé en Espagne, où il écrivit ses premières œuvres littéraires, qu’il fit publier après avoir démissionné en 1825. Rengagé dès 1826 comme chirurgien auxiliaire de la marine sur les instances de son père, il embarqua pour exercer principalement aux Antilles, hormis l’expédition internationale de 1827 en Grèce et en Méditerranée orientale.
Tout juste majeur puis orphelin de père comme de mère, Eugène démissionna de nouveau et définitivement de la chirurgie militaire en 1830. Héritier du titre héréditaire de chevalier, dandy voyageur alors surnommé « le Beau Sue », il dilapida en sept ans un héritage de près d’un million de francs, participant notamment à la fondation du Jockey-Club en 1834, s’essayant à la peinture et publiant surtout des romans feuilletons. Il avait pu vivre sept ans pour sa plume ; il dut alors en vivre. Il l’avait heureusement facile, et il pouvait la nourrir d’impressions exotiques, d’observations cliniques et d’expérience humaine. On peut distinguer ses romans par périodes selon leur inspiration principale.
Les premiers, publiés du temps de son aisance pécuniaire, exploitaient le filon mondain de l’exotisme et du roman maritime : Plik et Plok (1830 – 1831), Atar-Gull (1831), La Salamandre (1832) et La Vigie de Koat-Vën (1833), avant Le Morne-au-Diable ou l’Aventurier (1842).
Puis vinrent quelques romans de mœurs et de nombreux romans historiques, non sans une critique politique qui lui aliéna peu à peu ses relations mondaines : Cécile ou Une femme heureuse (1835), Latréaumont (1837), Deleystar (1838 – 1839), Arthur, journal d’un inconnu (1839), Jean Cavalier ou les Fanatiques des Cévennes (1840), Deux Histoires 1840), Le Commandeur de Malte (1841), Mathilde, mémoires d’une jeune femme (1841), Paula Monti ou l’Hôtel Lambert (1842) et Thérèse Dunoyer (1842). Son Histoire de la marine française (dix volumes de 1835 à 1837) acheva son exclusion des cercles légitimistes mais lui valut la Légion d’honneur en 1839.
Après son ralliement au socialisme en 1841, ses romans prirent la tonalité sociale, encore empreinte de paternalisme, qui fit le succès exceptionnel et durable des Mystères de Paris (1842 – 1843) et du Juif errant (1844 – 1845) : Martin l’enfant trouvé ou Mémoires d’un valet de chambre (1846 – 1847), Les Sept Péchés capitaux (1847 – 1852), Les Mystères du peuple (1849 – 1857), Les Enfants de l’amour (1850), Les Misères des enfants trouvés (1851), Miss Mary ou l’Institutrice (1851) et Le Bonne Aventure (1851).
Eugène Sue (1804 – 1857) vers 1840,
gravé par Ferdinand d’après Couveley.
Source : Wikimedia.
Désormais populaire, Eugène Sue s’engagea ouvertement avec la révolution de 1848 en publiant des ouvrages politiques : Le Républicain des campagnes (1848), Le Berger de Kravan ou Entretiens socialistes et démocratiques (1848), De quoi vous plaignez-vous ? (1849), Sur les petits livres de MM de l’Académie des sciences morales et politiques et sur les élections (1849), Eugène Sue aux démocrates socialistes du département de la Seine (1850), puis encore Jeanne et Louise ou les Familles des transportés (1853), La France sous l’Empire (1857) et Lettres sur la réaction catholique (1857).
Élu député en 1850 à Paris mais intimidé par son propre mandat, il ne prit la parole en séance que pour démissionner après le coup d’État de 1851. Emprisonné au Mont-Valérien, il refusa la grâce présidentielle et préféra s’exiler à Annecy, où le duc de Savoie lui accorda l’asile en dépit du clergé local. Il y mourut en 1857 après avoir achevé ses derniers romans de mœurs et sociaux : L’Amiral Levacher (1852), Ferdinand Duplessis ou les Mémoires d’un mari (1852 – 1853), Gilbert et Gilberte (1853), La Marquise Cornélia Alfi (1853), La Famille Jouffroy, mémoires d’une jeune fille (1854), Le Diable médecin (1854 – 1856), Les Fils de famille (1856), Les Secrets de l’oreiller (1858).
Une postérité sélective
Sa popularité n’avait pas encore faibli à en croire l’affluence à son inhumation, pourtant réalisée à 6 heures du matin et sans cérémonie. Cette popularité, qui a sans doute occulté la renommée antérieure des Sue, n’a pourtant pas suffi à sauver Eugène d’une certaine disgrâce. Les littéraires soulignent non sans raison les défauts de son œuvre, qui sont ceux de la littérature populaire : des intrigues foisonnantes, peu vraisemblables, au dénouement parfois laborieux, un style trop peu soigné, une prolixité excessive qui a fait dire qu’il « faisait gémir la presse »… Bien des histoires de la littérature française l’ignorent complètement ; l’Histoire de l’art dramatique de Théophile Gautier (1858-1859) qualifie Les Mystères de Paris de « bizarre épopée ».
Eugène Sue trouve une meilleure place dans l’histoire des idées. Juste après le rapport du docteur Villermé sur la condition ouvrière (1840), matrice d’une première loi sur le travail des enfants, cinquante ans avant l’encyclique sociale Rerum novarum (1891), son « épopée » sociale donnait la parole à ceux que la révolution industrielle attirait dans des villes où leur salaire ne suffirait qu’à les faire survivre. Son socialisme aux nuances paternalistes bien qu’anticléricales préparait donc bien la révolution de 1848, où l’engagement des catholiques libéraux allait faire ajouter la « fraternité » à notre devise républicaine.
L’influence d’Eugène Sue reste mesurée par l’usage populaire du nom commun pipelet et de son féminin pipelette, tirés du patronyme d’un couple de concierges des Mystères de Paris. Attestés respectivement dès 1854 et 1858, ils apparaissent aujourd’hui vieillis comme l’auteur lui-même. Leur admission dans le vocabulaire avait bien été préparée par leur parenté avec le verbe piper au sens ancien de « piauler, glousser », dont ils peuvent dériver. Mais ce patronyme était alors aussi porté à Paris par une autre famille de chirurgiens, et notamment par François Pipelet, ami de Jean-Joseph Sue et beau-père de la poétesse Constance de Théis.
Malgré lui, même dans ses nuances de socialisme, même dans sa raillerie sociale, Eugène Sue n’a donc pas complètement échappé à son milieu : il reconnaît lui-même « l’action exercée sur [son] esprit par l’éducation, par les traditions de famille » (encadré ci-dessous). Après lui, le titre héréditaire de chevalier hérité de son père se transmit à son demi-frère Joseph (1823 – 1903), attaché d’ambassade à Londres, puis inspecteur des Chemins de fer du Nord et receveur buraliste, qui ne paraît pas avoir eu de postérité. Il ne reste plus qu’un « honorable souvenir » collatéral pour les branches survivantes, avec la contribution de leur famille à la reconnaissance médicale de la chirurgie au xviiie siècle et à la conscience d’une fraternité sociale au xixe.
Pierre Jaillard.
Histoire de mes livres
J’écris, durant les loisirs de l’exil, non des Mémoires… rien ne saurait justifier de ma part une pareille prétention, mais (que l’on me pardonne cette ambitieuse expression) j’écris, si cela peut se dire, l’Histoire de mes livres.
Je m’explique.
Il m’a paru d’un salutaire enseignement de démontrer, par mon propre exemple, une nouvelle preuve de cette singulière et progressive évolution de l’âme et de la pensée grâce à laquelle, cédant à l’unique et irrésistible attraction du juste, du bien, du vrai, l’on peut parcourir l’immense distance qui sépare deux pôles radicalement opposés ; en d’autres termes, comment, appartenant à l’opinion légitimiste et catholique en 1830, j’ai eu l’honneur insigne, en 1850, d’être le candidat du conclave républicain-socialiste ; candidature précédemment déclinée par moi, parce que je ne me sentais pas à la hauteur de cet imposant mandat, et ratifiée par la majorité de mes concitoyens de Paris, qui m’ont nommé représentant du peuple à l’Assemblée nationale. Cette nomination sera la gloire éternelle de ma carrière littéraire. À cette gloire, la proscription a ajouté un dernier fleuron.
Ainsi, en 1830, partisan convaincu de la théocratie catholique et de la royauté légitime…, homme de plaisir et l’un des fondateurs du Jockey-Club (je cite ce fait comme caractéristique), j’écrivais La Vigie de Koatven, et j’en suis venu, depuis dix à douze ans, à concentrer ma vie, mes goûts, dans la retraite, le travail, la pratique sincère de la foi républicaine et du rationalisme, et j’achève Les Mystères du peuple.
Je puis, le front haut, la conscience sereine, dévoiler les causes, en apparence si contradictoires, qui m’ont ainsi transformé, me guidant pas à pas de l’erreur vers la vérité. Jamais je n’ai rien sollicité, rien obtenu des divers gouvernements de la France, et, pendant sept ans, soit dans l’armée de mer, soit dans l’armée de terre, j’ai acquitté, presque toujours en temps de guerre, la dette que m’imposait le service militaire de mon pays. J’ai reçu, unique faveur, la croix de la Légion d’honneur il y a quinze ans, grâce à la bienveillante et courtoise initiative de M. de Salvandy, alors ministre de l’Instruction publique.
Ma régénération, au point de vue politique et social, complètement désintéressée, a donc été amenée, je le répète, par la seule et irrésistible attraction du juste, du bien, du vrai, selon que je le prouverai quelque jour, par ce que j’oserai nommer l’Histoire de mes livres ; exposé sincère de l’action exercée sur mon esprit par l’éducation, par les traditions de famille, par mes goûts, par les événements politiques, par diverses influences personnelles, par celle même des endroits où j’écrivais, par le profond contraste des divers milieux sociaux où j’ai vécu, par la nature de mes études, par mes propres réflexions, par mon expérience croissante des hommes et des choses ; enfin, surtout, par les résultats inattendus, inespérés de plusieurs de mes œuvres, résultats qui m’ont affermi dans une voie où j’étais d’abord entré plus par l’instinct, par l’impulsion du cœur, que par le raisonnement.
Il me semble donc, abstraction faite de ce qui m’est particulier, qu’il peut y avoir un certain intérêt à suivre la marche ascensionnelle d’un esprit honnête, d’abord abusé, mais loyalement abusé, qui s’élève laborieusement, péniblement, vers la vérité éternelle, et trouve dans la conscience de cette vérité la satisfaction austère que nous donne la certitude de marcher dans le droit chemin et d’accomplir un grand devoir.
Ai-je besoin d’ajouter que cette Histoire de mes livres, destinée à servir un jour d’introduction à mes œuvres complètes, ne pourra être publiée que lorsque la France sera libre ? (…)
Eugène Sue.
Une page de l’Histoire de mes livres, Madame de Solms dans l’exil,
Turin, 1857.